Que reste t'il de la SNCF ?
En 2025

Que reste t'il de la SNCF ? En 2025
Transcription :
Avez-vous fait attention à cette petite subtilité la dernière fois que vous avez pris le train ?
Les annonces au moment du départ ne disent plus « La SNCF vous souhaite la bienvenue », mais « SNCF vous souhaite la bienvenue ».
Alors ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais en fait ça veut dire beaucoup !
Ça veut dire que la SNCF que vous avez en tête, celle qui assurait un service totalement intégré de l'entretien des voies ferrées à la circulation des trains que cela soit des TGV, des RER ou des express régionaux n'existe plus et que ça commence à se voir.
Par exemple, il y a quelques jours dans la presse pour justifier une nouvelle augmentation des tarifs, le PDG de l'entreprise Jean-Pierre Farandou rappeler que le TGV n'était pas un service public et qu'il devait gagner sa vie, couvrir ses frais, et financer notamment l'achat des rames de nouvelle génération, qui d'ailleurs tardent un peu à arriver, ce sera finalement pas avant 2026 aux dernières nouvelles.
Alors que s'est-il passé ? Quels épisodes à t'ont loupé ? C'est ce qu'on voit dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages !
Le chemin de fer en France est né, il y a bientôt deux siècles. Sa première ligne dans le pays a été établie en 1827 dans la région de Saint-Etienne. On l'a doit comme toutes les autres qui suivront à l’initiative privée.
Dans un premier temps, l'Etat ne s'intéressera aux Chemins de Fer que pour les réglementer une nécessité qui s'imposera en raison des nombreux accidents qui surviendront dans les premières années de leur histoire, avant de s’immiscer dans leurs affaires économiques.
Bon nombre d'entreprises ferroviaires se retrouvant en faillite et sans repreneur, l'Administration des Chemins de Fer de l'Etat est créée en 1878 pour assurer l'exploitation de lignes délaissées.
On découvre ainsi dès cette époque un principe qui ne se démentira jamais même si comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, on essaye bien souvent de l'oublier ou de le contourner : le chemin de fer, si l'on intègre le coût de ses infrastructures, n'est jamais rentable !
Les cinq grandes compagnies privées qui subsisteront jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale l'apprendront à leurs dépens. Ce sont le PLM, la Compagnie du Midi, la Compagnie de l'Est, la Compagnie du Nord et le Paris-Orléans.
Au 1er janvier 1938 toutes étant très lourdement endettées leur sort est scellé : elles rejoignent le réseau constitué par l'Administration des Chemins de Fer de l'Etat et pour l'occasion, une nouvelle entité est créée, elle s'appelle la SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français.
Sa vocation, c'est d'exploiter le réseau ferroviaire hexagonal dont les infrastructures restent la propriété de l'Etat. Il ne s'agit donc plus d'une administration, mais bien d'une entreprise, d'économie mixte dont 51 % du capital est détenu par l'Etat.
Et le reste me direz-vous ? Et bien, il se répartit entre les anciennes compagnies qui contrairement à ce que l'on pourrait penser continuent bel et bien d'exister.
Une convention datant du 31 août 1937 prévoit que pour dédommager leurs investisseurs, les actions de ces entreprises seront amortissables sur 45 ans, c'est-à-dire qu'elles perdront petit à petit de leur valeur jusqu'à ce qu'elles n'en aient plus aucune.
C'est ainsi que ce n'est qu'au 1er janvier 1983 que l'Etat français est devenu actionnaire à 100 % de la SNCF, une nouvelle entreprise portant le même nom étant créée mais sous la forme d'un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial cette-fois-ci pour succéder à la société d'économie mixte en reprenant l'ensemble des actifs, c'est-à-dire le personnel et le matériel.
Force est de constater que dans cette période allant de la fin de la guerre au début des années 2000 l'entreprise a connu des heures de gloire.
C'est l'époque de l'exploration de la grande vitesse sur rail, des records mondiaux étant régulièrement pulvérisés dans ce domaine, des trains prestigieux, le Mistral, le Capitole et bien d'autres qui font beaucoup pour l'image du pays à l'international, c'est aussi dans ces années que sont mis en service les très confortables trains Corail, ainsi que le TGV.
Pour autant, peut-on considérer que le train se porte bien en France ? Et bien paradoxalement non ! Il suffit de comparer ces deux cartes pour s'en convaincre.
Si jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale le réseau ferré n'a cessé de s'étendre, la période SNCF se caractérise par un recul constant et spectaculaire du nombre de km de voies ferrées exploitées.
C'est que la SNCF dès sa naissance a du composer avec un partenaire bien encombrant : la dette !
Celle-ci est constituée des déficits accumulés par les grandes compagnies dont elle est l'héritière, par la très lourde facture qu'il a fallut payer après guerre pour faire face aux destructions immenses que ses infrastructures et son matériel roulant ont subit, et elle ne fait que se creuser au fil du temps du simple fait des coûts de fonctionnement très importants engendrés par tout système ferroviaire.
Cette évolution est-elle propre l'hexagone ? Hé bien non !
Dans les autres pays européens c'est sensiblement la même évolution qui est connue.
A savoir que petit à petit dans chacun d'entre eux une unique grande entreprise nationale à capitaux publics a émergé pour prendre en charge l'exploitation du réseau ferré de son pays sans pour autant faire de miracles.
Toutes ces entreprises sont déficitaires et aucune n'est parvenue à trouver de solution pour concurrencer efficacement les transports routiers et aériens.
Pire même, dans tous les pays la part du ferroviaire recule que cela soit dans le domaine du transport des marchandises ou celui des voyageurs.
Le constat du manque de dynamisme du secteur est dressé dès les années 80 par la Commission Européenne qui s'en émeut et décide de se pencher sur le problème en se proposant de réinventer ce mode de transport.
Sa méthode repose sur deux piliers. La création d'un marché européen du transport sur rail et son ouverture progressive à la concurrence qui espère t'elle aura pour conséquence de réveiller les grandes entreprises monopolistiques nationales et de les dynamiser un peu.
Ses objectifs sont de parvenir à une meilleure qualité de service pour un coût moindre que ceux en vigueur en favorisant l'ouverture à la concurrence entre les opérateurs historiques et de nouveaux entrants et en mettant en place des normes techniques et de sécurité communes à l'ensemble des réseaux des différents pays pour faciliter les échanges internationaux.
Pour parvenir à ces fins quatre étapes ont été nécessaires. Dans le jargon européen, on parle de paquets qui sont des ensembles de directives et de règlements.
Les premières sont des actes juridiques qui fixent aux états membres un objectif et un délai pour l'atteindre, les seconds des décisions qui s'imposent immédiatement à eux.
Le premier paquet ferroviaire date de 2001, il a conduit à l'ouverture à la concurrence du transport de fret international et posé le principe de la séparation entre la gestion de l'infrastructure et celle de la circulation des trains.
Le deuxième de 2004 a poussé plus en avant l'ouverture à la concurrence du marché du fret ferroviaire.
Le troisième datant de 2007 a ouvert à la concurrence les services ferroviaires internationaux de transport de passagers et enfin, le quatrième en 2016 a organisé l'ouverture totale à la concurrence du secteur du transport ferroviaire.
Ces différents textes ont été transcrits dans le droit français par toute une série de décrets et de lois réformant le fonctionnement du ferroviaire, les principales étant celles du 8 décembre 2009, du 4 août 2014, et du 27 juin 2018.
Cet ensemble a conduit à la situation actuelle par laquelle la SNCF en vertu du principe de séparation des activités n'est plus une entreprise unique offrant un ensemble de services intégrés, mais un groupe constitué principalement de 7 entreprises publiques et à l'origine de la création de nombreuses filiales.
Ces 7 entreprises sont des Sociétés Anonymes dont l'Etat est le seul actionnaire.
« SNCF Réseau » et « Gares et connexions » sont les deux entités qui ont en charge l'infrastructure ferroviaire (les voies, la signalisation pour la première, les gares pour la seconde).
« Rail Logistics Europe » chapeaute les activités de fret,
« SNCF Voyageurs », prend en charge le transports de passagers en France et en Europe,
« Géodis » est une filiale dédiée au transport de fret et à la logistique dans le monde et Kéolis s'intéresse à l'exploitation et la maintenance de réseaux de transports qu'il s'agisse de métros, de tramways, de bus, et même parfois de trains en France et dans le monde.
L'ensemble de ces 6 entreprises est chapeauté par une 7e Société Anonyme qui les contrôle.
Il s'agit de la holding « SNCF ».
Ça, c'est pour le côté réforme structurel. Pour ce qui est de l'ouverture à la concurrence maintenant, le premier train de fret privé a circulé en juin 2005 entre Dugny dans la Meuse et Dillingen en Allemagne où il a transporté de la chaux.
Il faut bien avouer que 20 ans plus tard, le bilan de cette ouverture à la concurrence du fret ferroviaire est plutôt mitigé, la part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises en Europe continue de baisser au profit de la route et on vient d'assister en France à la disparition de « Fret SNCF » remplacée par deux nouvelles entités.
Tout cela mériterait une vidéo à part entière que je tâcherais de vous proposer prochainement sur cette chaîne.
Côté passager l'ouverture à la concurrence est également devenue une réalité.
Elle s'envisage selon deux modalités.
Les services librement organisés qui permettent à des opérateurs privés ou étrangers d'accéder librement aux infrastructures d'un pays pour y réaliser les dessertes qu'il souhaite.
L'ouverture de ce segment du marché concerne les lignes à grande vitesse, ainsi que les lignes grand parcours à vitesse classique traversant plusieurs régions, dont l'autorité organisatrice est l'Etat.
Concrètement, en France, ça ne se bouscule pas au portillon. En-dehors de la SNCF qui joue là à domicile, plusieurs prétendants ont échoué dans leur tentative de proposer un service dans un tel contexte : « Flix Train », « Railcoop » ou encore « Midnight Trains », ont ainsi jeté l'éponge avant même d'avoir réussi à faire circuler leur premier train.
Seuls deux opérateurs historiques étrangers ont lancé des services réguliers : « Trenitalia » entre Paris et Lyon, les Alpes et l'Italie, et bientôt entre Paris et Marseille, et la « Renfe » qui depuis Barcelone a établi des liaisons vers Lyon, Marseille, Toulouse et bientôt espère-t'elle Paris.
On attend du côté des entreprises privées dans les prochaines années « Kevin Speed », « Le Train » et « Proxima ».
Sur ce marché-là, le principe est simple : pas de subvention !
Le service doit s'auto-financer.
A ce petit jeu, la SNCF s'en sort, mais au prix de la pratique de tarifs élevés.
L'argument selon lequel il suffit de s'y prendre à l'avance ou de se tourner vers les TGV OuiGo pour trouver des tarifs plus intéressants n'est guère recevable par ceux qui prennent régulièrement le train, car en dehors des dates de départ en vacances que l'on peut en effet anticiper assez longtemps à l'avance, les modes de vie d'aujourd'hui sont tels que l'on a le plus souvent besoin de flexibilité dans nos modes de déplacements et celle-ci se paye au prix fort quand il s'agit de prendre un billet de train même avec un petit peu d'anticipation. C'est pire quand on a pas d'autre choix que de se décider à la dernière minute.
Ces deux concurrents subissent des pertes importantes que seuls leur taille et leur statut d'entreprise publique leur permet d'absorber.
Leur calcul est de fidéliser une clientèle sur le long terme en se différenciant notamment par leur qualité de service.
Ce n'est donc qu'au bout de quelques années que ces entreprises espèrent pouvoir gagner de l'argent sur ces relations.
J'entends souvent la remarque que comme ces entreprises payent des frais de péages moins élevés pour compenser les coûts qu'elles ont eu à subir pour adapter leurs trains pour qu'ils puissent circuler en France, elles peuvent se permettre des tarifs plus attractifs, mais ce n'est valable que les 3 premières années et c'est donc fini pour « Trenitalia » qui n'annonce pas pour autant de hausses de tarifs, il s'agit bien d'une stratégie d'acquisition d'une clientèle calculée sur le long terme.
La seconde modalité d'entrée sur le marché du transport ferroviaire de passagers est constituée par les services conventionnés. Ici, le principe est assez différent. Les régions ou l'Etat en tant qu'autorité organisatrice des transports sur leur territoire définissent un cahier des charges pour l'exploitation d'une ou plusieurs lignes et choisissent l'opérateur dont la proposition leur paraît être la plus adaptée à l'issue d'une procédure d'appel d'offres.
Celui-ci obtient la concession du service pour un certain nombre d'années.
Ici, le risque financier est moindre puisqu'à priori les coûts d'exploitation et les recettes sont connus à l'avance.
Dans ce contexte, l'entreprise retenue est un simple prestataire à qui il est demandé de rendre un service en l'échange d'une rémunération définie à l'avance.
Les gares à desservir, la fréquence de passage des trains, le fait qu'ils soient vides ou pleins, la politique tarifaire déployée ne sont pas sa préoccupation, mais celle de son commanditaire.
La SNCF via « SNCF Voyageurs » peut tout à fait être candidate pour répondre à ces appels d'offres et continuer ainsi à desservir des lignes comme elle le fait pour certaines depuis 1938.
Toutefois pour gagner en agilité, elle ne le fait pas directement, mais par l'intermédiaire de filiales qu'elle créée spécifiquement pour que les centres de décisions soient placés au plus près sur le terrain. Une adaptation qui n'aurait sans doute pas existé il faut le souligner si les réformes poussées par l'Union Européenne n'avaient pas existé.
Ces dernières années, cinq lots ont fait l'objet d'un appel d'offres.
Deux ont été remportés par « Transdev » qui exploitera à partir de décembre 2027 la ligne Nancy - Contrexéville qui réouvrira à l'occasion ainsi que la ligne Marseille-Toulon-Nice dès l'été 2025, et trois par des filiales de « SNCF Voyageurs » qui ont été mises sur les rails le 15 décembre dernier.
« SNCF Voyageurs Sud Azur » qui dessert l'Etoile de Nice, « SNCF Voyageurs Hauts-de-France » qui opère sur l'étoile d'Amiens et « SNCF Voyageurs Loire-Océan » qui a repris l'exploitation de deux lignes de tram-train circulant autour de Nantes.
Il ne s'agit là que d'un début puisque rien qu'en 2025 une 20 aine de nouveaux appels d'offres seront lancés.
Alors, oui, les conséquences de cette réforme du ferroviaire ont commencé à sérieusement se faire sentir.
Par le personnel des entreprises ferroviaires, bien sûr et plus particulièrement celui de la SNCF.
Les nouveaux embauchés ne bénéficient plus du statut de cheminot, ce sont désormais des salariés classiques régis par le code du travail.
Au fur et à mesure de la concrétisation des appels d'offres les personnels sont amenés a quitter leur employeur d'origine la SNCF pour rejoindre l'une des nouvelles filiales créées voire les rangs de l'entreprise concurrente qui a remporté le marché.
Tout cela est censé se faire sur la base du volontariat, mais gageons que la plupart des cheminots qui ont passé les épreuves de sélection pour un jour travailler à la SNCF se seraient bien passé de ce changement d'employeur.
Pour les voyageurs, force est de constater que prendre le train devient de jour en jour un peu plus compliqué !
Comment trouver simplement le meilleur tarif pour un trajet donné alors que le nombre de prestataires ne cesse de grandir et que les applications de la SNCF qui sont de loin les plus utilisées ne font bien naturellement pas mention des trajets proposés par ses entreprises concurrentes ?
Comment composer un trajet empruntant les trains roulant sous les bannières de différentes entreprises ferroviaires ?
Que se passe-t-il si l'un des trains empruntés pour une partie du parcours est retardé ou supprimé ?
Du temps de la SNCF opérateur unique, il était de sa responsabilité de trouver une solution aux voyageurs naufragés en mal de correspondance. Dès lors que plusieurs prestataires sont impliqués, et que les billets ont été acheté indépendamment les uns des autres, cette garantie n'est plus assurée !
Pour bénéficier des meilleurs tarifs, le voyageur est incité à acheter la carte de réduction qui correspond le plus à ses besoins. Mais si vous voyagez un peu en train et pas toujours sur la même ligne ni même dans la même région, vous vous rendrez compte très qu'il vous faudra devenir multi-carte pour vous en sortir !
Parce que non, la carte de réduction qui vous permettra de payer moins cher votre voyage en TGV ne sera pas valables sur les TER, et celle que vous aurez acheté en Bretagne, vous sera inutile dans le Grand-Est !
Vous l'aurez compris, la SNCF telle qu'on l'a connue pendant de longues années n'existe plus !
Elle a commencé à se transformer profondément.
Pour le meilleur ou pour le pire ? Il est sans doute un peu trop tôt pour le dire, mais rappelons nous des promesses portées par les différentes réformes ferroviaires qui se sont succédées, ça nous servira de base pour pouvoir juger sur pièces d'ici quelques temps puisque ça y est, de nouveaux opérateurs sont à pied d'œuvre :
Une meilleure qualité de service et des tarifs plus compétitifs.
Chiche !
Mais arrivera-t-on un jour en France à la hauteur de la qualité de service proposée par nos voisins et amis suisses ? Pour vous faire une idée des défis qui restent à relever pour y parvenir, je vous propose cette autre vidéo, mais attention,elle a de quoi vous donner envie de préférer le train !
Première Mondiale
au MOB

Fermeture de la LGV
Paris-Lyon
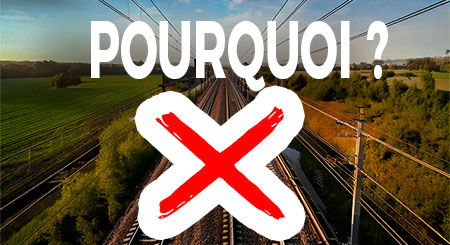
Le réseau ferré francilien
prêt pour les JO ?

Qui fait quoi ?
Sur le rail français ?

- © Aiguillages 2025